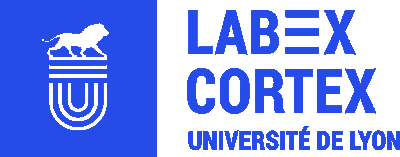Emporté par le cancer à l’âge de 82 ans, le neurologue Oliver Sacks était aussi un fabuleux raconteur d’histoires et un médecin plein d’humanité. Il s’est fait connaître du grand public par la publication, en 1985, de « L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau », un recueil de cas cliniques atypiques, traduit dans de nombreuses langues. Le Pr Emmanuel Broussolle, lui-même neurologue et clinicien, évoque l’homme, le chercheur et le vulgarisateur.
Le neurologue et écrivain Oliver Sacks est décédé chez lui le 30 août dernier des suites d’un cancer. Jusqu’au bout, l’auteur du célèbre « L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau », florilège de cas cliniques aussi rares qu’extraordinaires, aura cherché à explorer les mystères du cerveau et du comportement humains.
Né à Londres en 1933, Oliver Sacks fait des études de médecine au Queen’s College de l’université d’Oxford, qu’il complète par un doctorat aux Etats-Unis. Il s’installe à New York en 1965 et exerce comme neurologue dans différents établissements de soins. A partir des années 90, il enseigne la neurologie dans plusieurs universités de médecine (Albert Einstein, New York, Columbia). Il a notamment utilisé la musique pour soigner certains troubles psychiques.
Parallèlement à ses activités de clinicien et d’enseignant, il mène une carrière d’écrivain. Oliver Sacks a écrit une dizaine de livres dans lesquels il raconte son expérience avec ses patients. Parmi les plus connus : L’Éveil (1973), L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau (1985), Des yeux pour entendre : voyage au pays des sourds (1989), Musicophilia (2008) ou son dernier, L’odeur du si bémol (2014), dans lequel il explore l’univers des hallucinations. Ses livres sont traduits à ce jour dans 25 langues. Oliver Sacks a en outre régulièrement collaboré aux magazines The New Yorker et The New York Review of Books, ainsi qu’à d’autres publications médicales, scientifiques ou généralistes.
Cortex Mag a demandé au Pr Emmanuel Broussolle, lui-même neurologue et clinicien, d’évoquer l’homme, le chercheur et le vulgarisateur.
Comment avez-vous découvert les travaux d’Oliver Sacks ?
C’était en 1986, j’étais jeune chercheur aux Etats-Unis. La lecture de « L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau », son recueil de petites histoires décrivant des syndromes du type Gilles de La Tourette, Asperger, prosopagnosie [1], etc. m’a profondément marqué : je m’en souviens encore. Il y a eu aussi, au début des années 90, le film « Awakenings » inspiré de son livre « L’Eveil », formidablement interprété par Robin Williams et Robert de Niro. Un film admirable en ce qu’il reflète la profonde humanité d’Oliver Sacks et l’empathie dont il faisait preuve dans ses essais cliniques. Pour lui, le patient n’était pas d’abord un objet de recherche scientifique, mais une personne en souffrance qu’il voulait comprendre et soulager. Il instituait une relation très forte avec lui. Pour lui, le malade devait participer à la recherche et à sa guérison. En ce sens, les neurologues de ma génération lui doivent beaucoup.
Sur le plan neurologique, quels sont ses principaux objets de recherche ?
Oliver Sacks n’était pas seulement un humaniste et un vulgarisateur exceptionnel, il était aussi un chercheur de premier plan. Il a ainsi publié dans les meilleures revues de neurologie [2]. Il s’est notamment intéressé aux rescapés de l’épidémie d’encéphalite léthargique de von Economo (1915-1925), qui présentaient un syndrome parkinsonien proche de la maladie de Parkinson en testant les effets de la L-Dopa, molécule utilisée pour soigner les malades atteints de la maladie de Parkinson (c’est la trame du film « L’Eveil », (>lire l’encadré)). Il a mené des recherches sur l’autisme et le syndrome d’Asperger. Il a aussi travaillé sur les « slow virus diseases » ou « maladies à virus lents » (Prix Nobel de Médecine de Daniel Carleton Gajdusek en 1976), recherche qui a évolué ensuite vers le concept des « maladies à Prions » (Prix Nobel de Médecine de Stanley Prusiner en 1997). Parmi ses travaux, ceux qui rejoignent le plus mes propres recherches, outre la maladie de Parkinson, portent sur l’association de plusieurs processus dégénératifs dont la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Oliver Sacks a étudié ce qu’on appelle le syndrome de Guam ou complexe de l’Ile de Guam. Il s’agit d’une maladie endémique d’une île de l’archipel des Mariannes dans le Pacifique. Elle se présente sous la forme d’une maladie dégénérative associant les symptômes de la SLA et de la démence parkinsonienne et touchant principalement des hommes dans la force de l’âge (>lire l’encadré).
Oliver Sacks, spécialiste des troubles de la communication, était aussi un homme de communication…
Cela ne fait aucun doute. A côté de ses ouvrages de vulgarisation, il n’a cessé de publier des articles dans la presse grand public et a entretenu un rapport direct avec lui via les nouveaux moyens de communication. Par-dessus tout, Oliver Sacks avait un don pour raconter des histoires. Il savait trouver les mots pour nous expliquer la singularité d’une personne souffrant d’un dysfonctionnement et nous rapprocher d’elle. Nul doute que ce talent a déclenché chez de nombreux jeunes gens le désir de devenir à leur tour médecin, psychologue ou neurologue.
« Awakenings » : le film qui montre l’empathie de Sacks pour ses patients
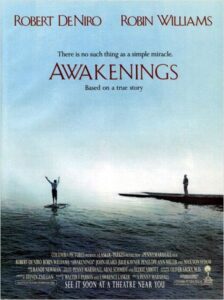 Réalisé par Penny Marshall, le film « Awakenings » est inspiré du livre « L’Eveil », premier recueil de cas cliniques publié en 1974 par Oliver Sacks. Le film retrace l’histoire d’un jeune chercheur, le Dr Malcom Sayer (Robin Willliams), à qui l’on confie un groupe de malades chroniques atteints de troubles psychiques profonds. Sayer découvre que la plupart sont des rescapés de l’épidémie d’encéphalite léthargique, une forme de « maladie du sommeil » qui a sévi au début du XXe siècle. Il va peu à peu les ramener à une vie normale en utilisant un médicament destiné aux patients parkinsoniens. Notamment, Leonard Lowe (Robert De Niro), qui deviendra son ami. Un film qui met en évidence la profonde humanité du Dr Oliver Sacks.
Réalisé par Penny Marshall, le film « Awakenings » est inspiré du livre « L’Eveil », premier recueil de cas cliniques publié en 1974 par Oliver Sacks. Le film retrace l’histoire d’un jeune chercheur, le Dr Malcom Sayer (Robin Willliams), à qui l’on confie un groupe de malades chroniques atteints de troubles psychiques profonds. Sayer découvre que la plupart sont des rescapés de l’épidémie d’encéphalite léthargique, une forme de « maladie du sommeil » qui a sévi au début du XXe siècle. Il va peu à peu les ramener à une vie normale en utilisant un médicament destiné aux patients parkinsoniens. Notamment, Leonard Lowe (Robert De Niro), qui deviendra son ami. Un film qui met en évidence la profonde humanité du Dr Oliver Sacks.> Voir la bande-annonce sur AlloCiné.
Syndrome de Guam : l’hypothèse de Sacks
 Le neurologue Oliver Sacks a étudié de près une maladie neurologique affectant l’ethnie Chamorro de l’île de Guam, la plus grande île de l’archipel des Mariannes. Cette maladie neuro-dégénérative associe les symptômes de la sclérose latérale amyotrophique et ceux de la démence parkinsonienne. On parle aussi du complexe SLA-parkinsonisme-démence (ALS/PDC, ou lytico-bodig). Elle se traduit par une paralysie progressive accompagnée de manifestations de démence. Sacks a mis en avant le rôle d’une neurotoxine, la BMAA (béta-méthyl-amino-alanine). Selon lui, cette toxine serait produite par une cyanobactérie présente dans les graines d’un arbre à port de palmier, le cycas (Cycas rumphii). L’intoxication se ferait par la consommation alimentaire de ces graines ou de chauves-souris se nourrissant de ces graines (photo).
Le neurologue Oliver Sacks a étudié de près une maladie neurologique affectant l’ethnie Chamorro de l’île de Guam, la plus grande île de l’archipel des Mariannes. Cette maladie neuro-dégénérative associe les symptômes de la sclérose latérale amyotrophique et ceux de la démence parkinsonienne. On parle aussi du complexe SLA-parkinsonisme-démence (ALS/PDC, ou lytico-bodig). Elle se traduit par une paralysie progressive accompagnée de manifestations de démence. Sacks a mis en avant le rôle d’une neurotoxine, la BMAA (béta-méthyl-amino-alanine). Selon lui, cette toxine serait produite par une cyanobactérie présente dans les graines d’un arbre à port de palmier, le cycas (Cycas rumphii). L’intoxication se ferait par la consommation alimentaire de ces graines ou de chauves-souris se nourrissant de ces graines (photo).> Syndrome de Guam (Wikipedia).
«L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau» : un florilège de cas cliniques extraordinaires
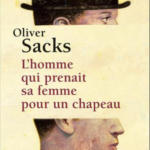 Oliver Sacks s’est rendu célèbre par la publication, en 1985, de «L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau», recueil de cas cliniques hors du commun. Le point commun de ces histoires ? Des lésions cérébrales qui entrainent des troubles comportementaux à peine croyable. Ces récits montrent les difficultés que rencontrent parfois les neurologues face à des cas qui illustrent la complexité du cerveau humain.
Oliver Sacks s’est rendu célèbre par la publication, en 1985, de «L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau», recueil de cas cliniques hors du commun. Le point commun de ces histoires ? Des lésions cérébrales qui entrainent des troubles comportementaux à peine croyable. Ces récits montrent les difficultés que rencontrent parfois les neurologues face à des cas qui illustrent la complexité du cerveau humain.> Présentation de 3 cas cliniques célèbres avec Sciences et avenir.
La bibliographie des ouvrages d’Oliver Sacks (au Seuil)
La notice d’Oliver Sacks sur Wikipedia
« Oliver Sacks, le voyant » : très bel article de Jean-Claude Ameisen (« Sur les épaules de Darwin ») dans Le Monde à l’occasion de la sortie de « L’Œil de l’esprit », en 2012