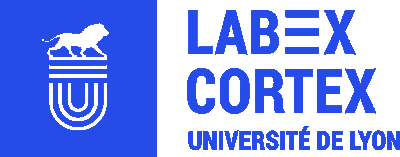L’exposition Le temps d’un rêve, qui se tient au musée des Confluences de Lyon, aborde une thématique méconnue du rêve : sa dimension collective. Pour Perrine Ruby, membre du comité scientifique de l’exposition, collecter des récits oniriques faits à un même moment historique permet de voir ce qui touche les individus de façon commune. Et dévoile les effets de la culture ou de la politique sur les psychés.
Photo « La petite dormeuse aux nénuphars » © musée des Confluences – Olivier Garcin
Combien y’a-t-il de manières d’aborder la question du rêve et de son importance dans nos vies ? Au moins huit, d’après l’exposition Le temps d’un rêve, à découvrir jusqu’au 24 août 2025 au Musée des Confluences, à Lyon. Passés l’entrée et le coup d’œil jeté à Heidi, la pieuvre filmée dans son sommeil et dont les changements de couleur reflétant des tentatives de camouflage témoignent sans doute de la vie onirique, on entre dans une première salle qui questionne le rêve sous l’angle de l’expérimentation scientifique et des neurosciences. Viennent ensuite plusieurs escales consacrées aux dimensions historique, médicale, ethnographique, anthropologique, artistiques, psychologique du rêve et à l’oniromancie.
Clôturant la visite, le dernier espace nous plonge dans des récits de rêves. Reproduits sur les murs blancs de la pièce et accompagnés pour certains de leurs dessins, les écrits intimes ont été consignés par des rêveurs à des moments clés de l’histoire comme à l’aube de la Seconde Guerre mondiale et lors de la crise du Covid. Des témoignages qui montrent comment les rêves révèlent l’impact des événements à l’échelle individuelle, mais aussi collective. Rarement évoquée, cette dimension collective du rêve est précieuse : alors que les consciences éveillées peuvent y être aveugles, les psychés rêvantes révèlent les bouleversements en cours ou en gestation dans la société en mettant les émotions sur le devant de la scène. Explications avec Perrine Ruby, chercheuse au Centre de recherches en neurosciences de Lyon (CRNL) et membre du comité scientifique de l’exposition.
Couvrant les murs de l’espace dédié à l’approche sociologique du rêve, les récits extraits du livre Rêver sous le IIIe Reich de Charlotte Beradt sont particulièrement importants à vos yeux. Pourquoi ?
Ce recueil de récits oniriques a été une révélation : en le lisant, j’ai pris conscience de la puissance métaphorique qui s’exprime à travers les rêves, aussi bien à l’échelle individuelle que d’un point de vue collectif. J’ai lu cet ouvrage avant de travailler sur le rêve et son souvenir n’est pas étranger au fait que j’ai choisi de faire de la recherche sur ce sujet.
Charlotte Beradt était une Berlinoise juive qui travaillait dans la presse des années 1930. Alors que l’avènement du nazisme plongeait les gens dans l’effroi et les réduisait au silence, elle a eu l’idée improbable de documenter ce moment terrible de l’histoire en collectant leurs rêves auprès d’habitants de la capitale allemande. Entre 1933 et 1939, elle a réuni près de 300 récits confiés par des gens ordinaires comme des chefs d’entreprises, des femmes de ménage ou encore de petits commerçants. Les récits ont été publiés pour la première fois en 1966. Ils montrent la surveillance et l’oppression subies par la population, l’emprise du régime totalitaire jusque dans le sommeil…un objectif clairement annoncé par Hitler.
Un rêveur voit ainsi les murs sensés le cacher s’écouler autour de lui. D’autres s’expriment dans des langues étrangères par peur d’être espionnés. Lorsqu’on lit Rêver sous le III Reich, et avec le recul historique, on ne peut qu’être stupéfait de voir comment la mise en scène des émotions ressenties par les individus est juste et révèle l’inhumanité et la coercition du régime nazi, déjà bien là, et qui se déploieront pendant la guerre.

Les rêves dont nous nous souvenons sont en effet souvent très colorés émotionnellement. Comment l’expliquez-vous ?
Parce que les émotions sont au cœur même du processus de formation des rêves. Il existe aujourd’hui plusieurs hypothèses quant au rôle adaptatif du rêve. Celle sur laquelle je travaille attribue au rêve une fonction de régulation des émotions : dans l’intimité de notre sommeil, nous revivons les situations de la journée et les émotions qui les ont marquées. Le travail du rêve, comme l’appelait Freud, consiste à convoquer les souvenirs et à les transformer, à proposer une nouvelle perspective. En utilisant un puissant outil, la métaphore, le rêve exprime les émotions sans censure ni gêne telles qu’elles sont ressenties. Ces métaphores révèlent l’intelligence et la finesse du cerveau rêvant qui arrive à trouver des représentations symboliques qui font mouche.
Lorsqu’en rêve, une vague vous submerge, n’est-ce pas ainsi que l’émotion vous saisit quand, dans la vie, vous vous sentez dépassé par les évènements ? Le travail du rêve est associé à une diminution de l’intensité émotionnelle des souvenirs, c’est ce qu’on a pu constater grâce à une étude faite au laboratoire. L’émotion ressentie lors de la version rêvée d’un souvenir négatif ou positif est moins forte. Rêver semble donc bien aboutir à une régulation de nos émotions, c’est-à-dire à une relative neutralisation émotionnelle de nos souvenirs.
On ne trouve pas que des rêves de guerre dans la salle du musée. Pouvez-vous nous parler des autres ?
Des rêves de personnes en prison sont aussi exposés. En prison, comme ailleurs, les rêves parlent des émotions que nous avons besoin de réguler, donc possiblement perturbantes, qui évoquent des contextes où l’individu est malmené par les règles sociales, par la coercition ou la discrimination. Les rêves sont par ailleurs un moyen d’évasion, aussi beaucoup de rêves de prisonniers exposés parlent de liberté.
Dans Rêver sous le capitalisme, le documentaire réalisé par Sophie Bruneau en 2018 dont on peut visionner un court extrait pendant la visite, ce sont douze personnes qui évoquent et interprètent leurs rêves représentant cette fois-ci le monde du travail. Evocation de zombis, cadavres, fantômes… La souffrance vécue par ces rêveurs la journée est évoquée sans ambages ni pincettes dans leurs rêves.
Il y a aussi des rêves liés à la période Covid…
En effet. On trouve quelques extraits de l’enquête sur le sommeil et les rêves réalisée en France du 6 avril au 11 mai 2020 et dont les résultats sont publiés dans l’ouvrage Rêver pendant le confinement. La crise sanitaire a été une situation extrême : j’ai cherché à comprendre l’impact qu’elle avait eu sur le sommeil et les psychés. Un autre objectif était de documenter l’époque, d’essayer de mieux en comprendre ses impacts et enjeux en se penchant sur une lecture onirique des évènements.
Parmi les récits collectés auprès de plus de 3300 personnes pendant le premier confinement, les rêves négatifs et les cauchemars ont mis en scène la peur de la maladie de soi et des proches, la crainte de la mort et de la surcharge de l’hôpital. Comme on pouvait s’y attendre. Mais on a découvert aussi des sujets de préoccupation tout aussi intenses comme la peur de l’intrusion dans l’intimité, de l’enfermement, de la coercition, de l’avènement d’un régime totalitaire, de l’incertitude pour l’avenir.
Une de mes surprises a été de découvrir qu’un petit pourcentage de personne a fait des rêves plus positifs que d’habitude. On a en effet reçu beaucoup de rêves mettant en scène la réalisation de désirs impossible à l’éveil à ce moment-là. Certains ont rêvé de courir dehors, voir les amis et la famille, faire la fête, danser, embrasser ses proches, partir en voyage. Beaucoup de rêves érotiques ont été rapportés aussi. D’autres rêves ont proposé de la positivité à une échelle plus collective, plus large: ceux par exemple d’un monde déconfiné, ou sauvé de tous ses maux, et où les humains vivent en harmonie avec la nature. Ces rêves positifs sont sans doute un mécanisme pour rétablir l’équilibre émotionnel en contrebalançant les émotions négatives vécues le jour. Encore une fois, un outil de régulation émotionnel.

Rêver pendant le nazisme, le confinement ou sous le capitalisme. Au-delà de leur contexte souffrant, ces récits nous parlent de résistance individuelle, celle des rêveurs. Qu’entendez-vous par cela ?
Ce qu’on peut noter dans les récits rapportés, c’est la volonté des âmes malmenées à lutter contre leur oppresseur le temps d’un rêve. Ce qui n’était pas possible à priori pendant la vie éveillée. Ainsi le récit de cet Allemand, dans Rêver sous le IIIe Reich, qui relate faire le salut nazi et observe son bras monter tout doucement, mais contre son gré. A travers cette représentation métaphorique, on devine une tentative de la conscience de s’exprimer pour s’opposer au régime. La première étape pour résister est de prendre conscience du problème et le regarder en face, le rêve fait ça.
En France en 2020, comme entre 1933 et 1939 en Allemagne, peu de rêves ont mis en scène une résistance, ça témoigne d’une certaine sidération. Mais le rêve aide à dépasser cet état. Un des récits de Rêver pendant le confinement, met d’ailleurs en scène un personnage qui se rebelle : il se fait tirer dessus par des policiers parce qu’il n’a pas d’attestation, il fuit d’abord puis se retourne et rend les tirs.
Collecter des rêves constituerait en outre une autre forme de résistance ?
Oui je pense. Parce que regrouper des récits de rêves réalisés à un même moment dans une population donnée permet de voir ce qui touche les individus de façon commune et de mettre en exergue les effets de la culture ou de politique sur les psychés. C’est pour cette raison que j’ai tenu à dédicacer l’ouvrage Rêver pendant le confinement au président de la république en place en 2020. Charlotte Beradt est entrée en résistance politique lorsqu’elle a montré la violence du nazisme une fois le régime éteint. Sophie Bruneau, elle, dénonce comment le système capitaliste néolibéral maltraite aujourd’hui la psyché contemporaine. Dans l’enquête réalisée pendant le confinement, les rêves rapportés ont montré comment des décisions politiques arbitraires ont inspiré la crainte du totalitarisme. Beaucoup de personnes ont vécu le confinement comme une brimade et une privation non consentie de liberté. En témoigne le rêve de cette jeune femme qui, enfermée dans une sorte de jardin d’Eden, est empêchée d’en sortir par des créatures mi-hommes mi-machines avec lesquelles il était impossible de dialoguer. Nos rêves nous parlent de nous, il est important de les écouter !
Participez à une enquête sur les rêves !
Aidez-nous à comprendre les mécanismes des souvenirs de rêve en complétant le questionnaire ci-dessous.
Il est anonyme et nécessite 20 à 30 minutes de votre temps.
Vous pouvez le remplir dès à présent si vous vous souvenez de votre rêve de cette nuit.
Si ce n’est pas le cas, vous pourrez remplir ce questionnaire le jour où vous vous souviendrez d’un rêve au réveil.
Pour participer, cliquez ici : https://form.crnl.fr/index.php/168266?lang=fr
Un très grand merci pour votre contribution !Ph